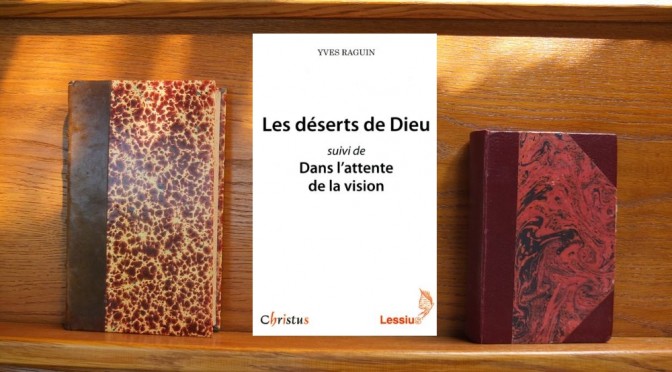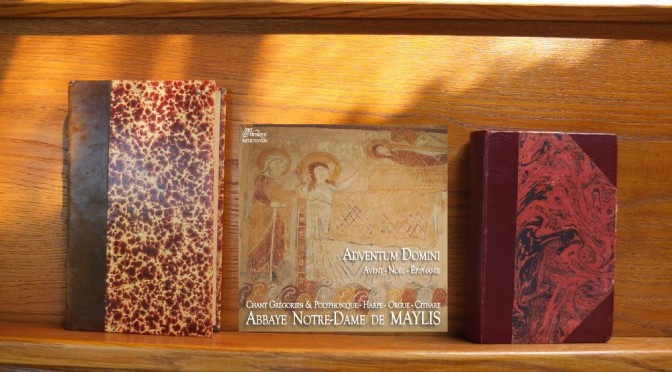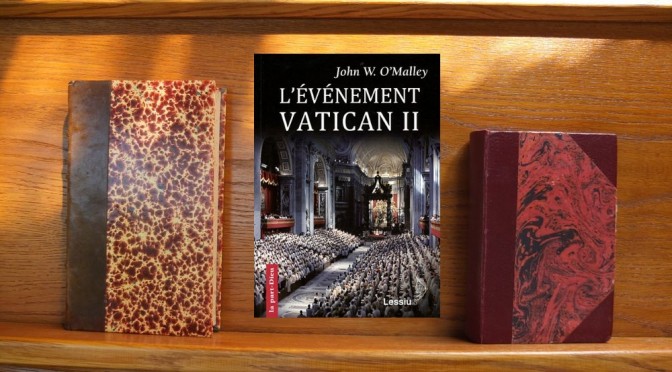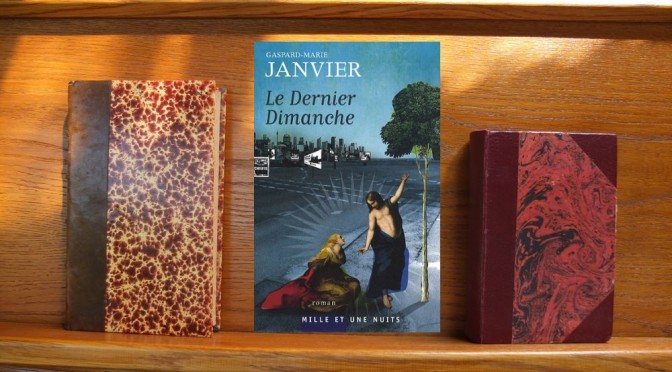RAGUIN, Yves, s.j.
Les déserts de Dieu, suivi de : Dans l’attente de la vision, Editions Lessius, Bruxelles, 2015, 311 pages.
Les déserts de Dieu suivi de Dans l’attente de la vision est constitué de quatre vingt méditations inédites du Père Yves Raguin s.j. qui de son vivant n’ont été distribuées qu’aux amis proches sur le modèle de la « lettre spirituelle ».
« Entre la grasse Égypte et la terre promise il y a toujours un désert » lit-on en exergue. Entre la grasse Égypte, où le peuple élu est partagé entre l’esclavage du travail et la consolation de la consommation (Nombres 11, 5), et la Terre promise tout au bout du chemin, il y a ce désert déroutant au tout au long duquel « Dieu convie ceux qu’il aime à la table qu’il prépare de ses propres mains dans la solitude du désert » et leur « sert la manne, les cailles et l’eau qu’Il fait couler du rocher »
D’une profonde simplicité, ces pages limpides « résonnent des accents de St Jean de la Croix et de Bernard de Clairvaux ». Recueillies et retravaillées sur plus de 20 ans par un fils de Saint Ignace, elles témoignent aussi de ce sain réalisme qui se veut attentif au véritable enracinement de la vie spirituelle dans une vie humaine accomplie, comme le manifeste par exemple le prologue :
« Pour l’adolescent qui entre dans la période de maturité, le désert devient un élément essentiel. Il est le lieu de formation de la personnalité. A cet âge l’homme est capable de lutter corps à corps avec la solitude et d’en triompher dans un approfondissement de sa personnalité.
Essayer de fuir ce désert, c’est se condamner à rester dans un état d’enfance. Il semble que chez beaucoup de nos contemporains cette peur du désert est devenue comme instinctive. On parle beaucoup de communauté, de relations interpersonnelles, on sent le besoin impérieux d’ « être avec »… Si cette tendance en arrive à supprimer l’attrait du désert, je crois qu’il risque de manquer un élément essentiel à la formation humaine. »
Elles visent donc à nous faire partager l’expérience d’une rencontre, d’un compagnonnage dans la solitude, du jeu de Dieu qui donne parfois l’impression de se jouer de nous, mais nous soutient fidèlement, même si nous n’y comprenons plus rien, pour peu que nous Lui fassions confiance. Qu’il est bon alors d’entendre une voix fraternelle pour nous encourager à lâcher prise là où il faut sans lâcher pied ! S’en suit alors pour qui accepte de lui emboîter le pas un chapelet de plus de 80 méditations de deux à trois pages, non pour faire le tour du monde avec Jules Verne, même si l’auteur a lui aussi beaucoup voyagé avant de se fixer à Taiwan mais pour scander ce temps de préparation à Pâques d’une ou deux méditations par jour et nous préparer par une attente active, c’est-à-dire attentive à reconnaître les signes du passage de Dieu qui nous entraîne toujours au-delà dans une rencontre renouvelée avec l’autre aussi différent soit-il tant il est vrai que « l’altérité de Dieu est d’abord ressentie dans l’abîme d’une altérité vécue » (B. Vermander, préface p.13)
« Lorsqu’il achève Les déserts de Dieu, Yves Raguin (1912-1998) s’apprête à entrer dans sa 56e année. Tourangeau, entrée au noviciat de la Compagnie de Jésus en 1930, il a commencé des études de chinois en 1942, études qu’il poursuit de 1946 à début 1949 à Harvard. Il arrive en avril de la même année dans Shanghai assiégée, dont il sera expulsée en août 1953. Il dirige l’équipe du Dictionnaire Ricci à Taiwan à partir de cette date, et enseigne l’histoire chinoise et la philosophie bouddhiste au Vietnam de 1959 à 1964. Rentré à Taiwan, fondant et dirigeant l’Institut Ricci de Taipei, il exercera une activité de conférencier et directeur spirituel en Asie, en Amérique du nord et en Europe. » rappelle Benoît Vermander s.j., successeur deY. Raguin à l’Institut Ricci, au tout début de sa préface au livre.