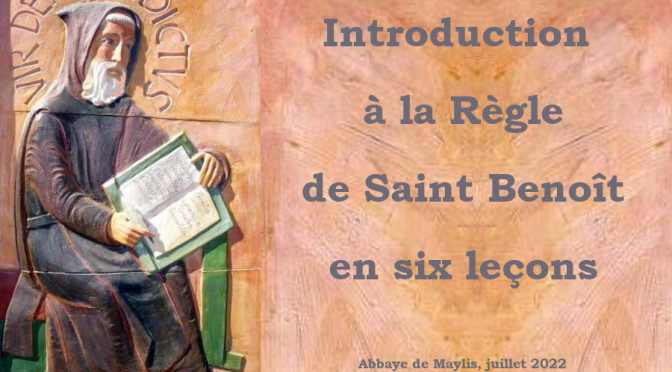Service et prière à Maylis
Besoin de recul, de te mettre au vert ? Que dirais-tu de venir pour un temps de service et de prière à l’abbaye ?
Étudiants et jeunes pros, vous êtes les bienvenus en tous temps, mais particulièrement cet été !
Quand et combien de temps ?
Nous vous invitons cet été, de fin juin à début septembre : un jour, trois jours, une semaine… à chacun selon ses disponibilités. Pas d’inquiétude pour la participation aux frais d’hôtellerie : si vous pouvez laisser quelque chose ce sera bienvenu, sinon vos mains y pourvoiront !
Activités variées
Les activités ne manquent pas, et il y en a pour tous les goûts ! Nous avons besoin d’aide, et nous serons heureux de travailler avec vous :
- jardin
- gestion de fruits et légumes
- défrichage
- aide dans nos plantations
- restauration de bâtiments
- bricolages en tous genres
- rangements et nettoyages





Et puis aussi…
Ce sera aussi : retraite, service, rencontre des moines et vie avec eux, découverte d’une abbaye, rencontre d’autres jeunes – ou moins jeunes – qui seraient là en même temps. De quoi bien se couper d’un « métro-boulot-dodo » sans rester à ne rien faire. Une expérience très bénédictine d’ORA ET LABORA en communauté ! Laissez-vous tenter.
C’est une bonne tentation !
Retraite Faire le Point
Du samedi 13 juillet au vendredi 19 juillet : 10e ÉDITION !
Au cœur de l’été, un moment particulier : la Retraite Faire le Point. Se poser pour un discernement. Là, c’est du sérieux. On ajoute des enseignements qui devraient accompagner un travail intérieur et ouvrir à l’écoute du Seigneur.
Voyez le menu sur la page qui est dédiée à la retraite :
D’autres retraites organisées par des moines et moniales sont proposées sur ce site :
A bientôt !
Pour envoyer une demande au frère Oliveto, responsable de l’accueil :